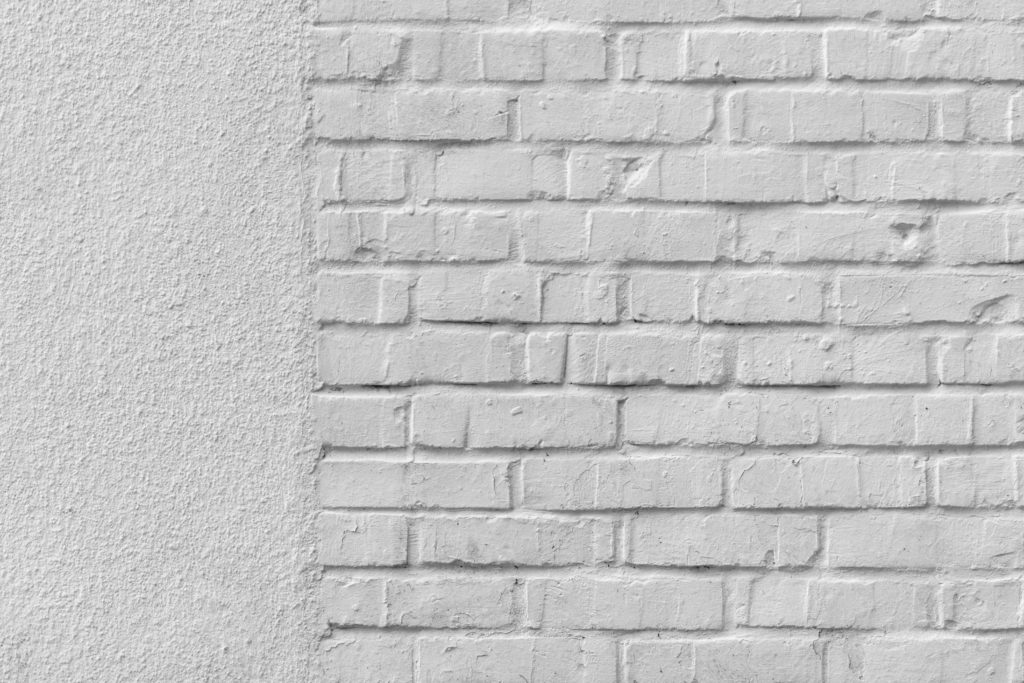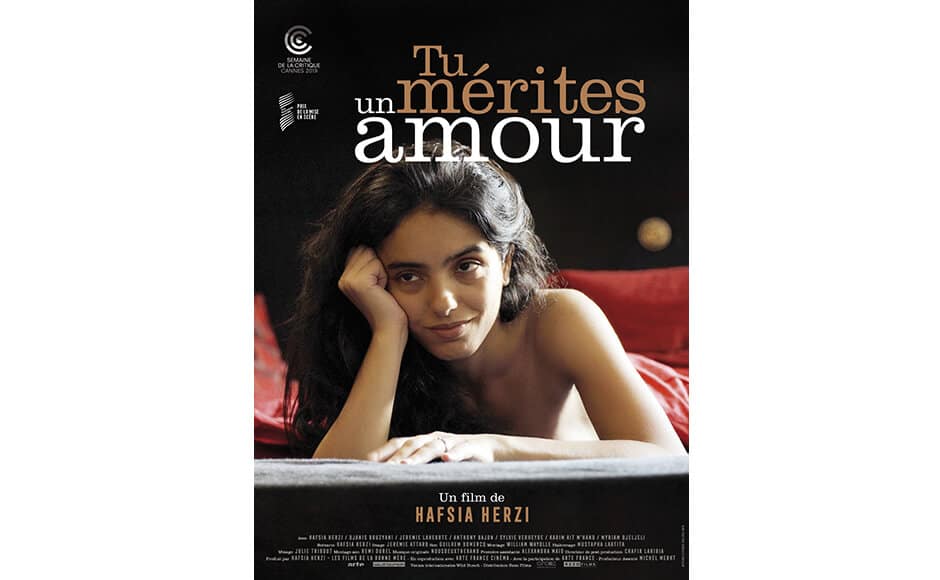
Ça faisait longtemps que je n’avais pas écrit un article sur un film. Avant, c’était ma tradition du jeudi. Pas que j’ai arrêté d’en voir, quoique… c’est vrai qu’ici, j’ai moins l’occasion d’aller au ciné. Les places sont chères et il n’y a qu’un seul cinéma qui fait partie d’une grande chaîne (alors ouais bof, pas envie d’encourager ce genre de trucs). Alors même si une asso se décarcasse pour y programmer de beaux films, ça le fait moins qu’à l’Utopia de Bordeaux où avec la carte, je pouvais aller voir des tas de documentaires et de films, au moins deux fois par semaine pour 4 euros (3,50 quand j’ai commencé).
Pas non plus que je n’ai pas vu de films qui méritaient un article. Le dernier qui m’a vraiment bouleversifiée (je sais, ce mot n’existe pas) est Shéhérazade mais je ne suis pas sûre que j’aurais réussi à en dire des choses plus intelligentes que tout ce que vous avez pu lire. Mais si vous ne l’avez pas vu, allez-y parce que c’est un très très très beau film sur l’amour.
Alors voilà, Tu mérites un amour n’est pas un film immense. Il ne m’a pas fait vivre des émotions très intenses mais c’est un joli film. Et puis, grâce à ce film, j’ai découvert un poème de Frida Kahlo qui lui, m’a bouleversifiée (toujours pas français).
Alors, je voulais te l’offrir (et me l’offrir à moi, par la même occasion) en ces temps de fin d’année qui sentent les espoirs déçus et les attentes insensées parce qu’au final, qu’est-ce qui compte plus que l’amour ?
Tu mérites un amour – Frida Kahlo
Tu mérites un amour décoiffant, qui te pousse à te lever rapidement le matin, et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir.
Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lors qu’il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau.
Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu’il regarde dans tes yeux, qui ne s’ennuie jamais de lire tes expressions.
Tu mérites un amour qui t’écoute quand tu chantes, qui te soutiens lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t’accompagne dans ton vol, qui n’a pas peur de tomber.
Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et t’apporterait le rêve, le café et la poésie.